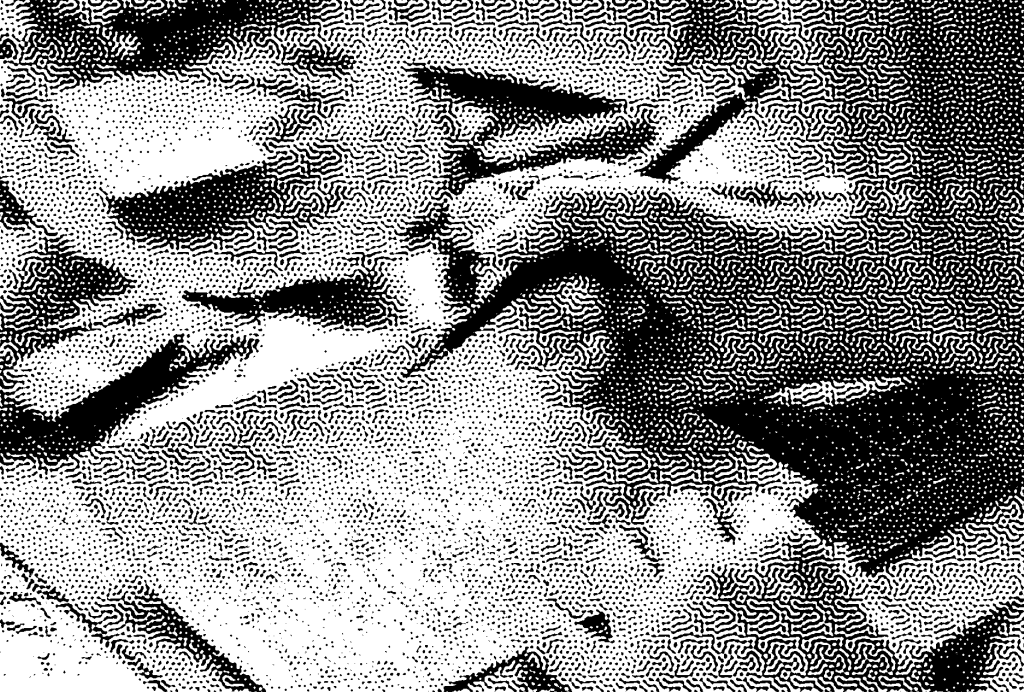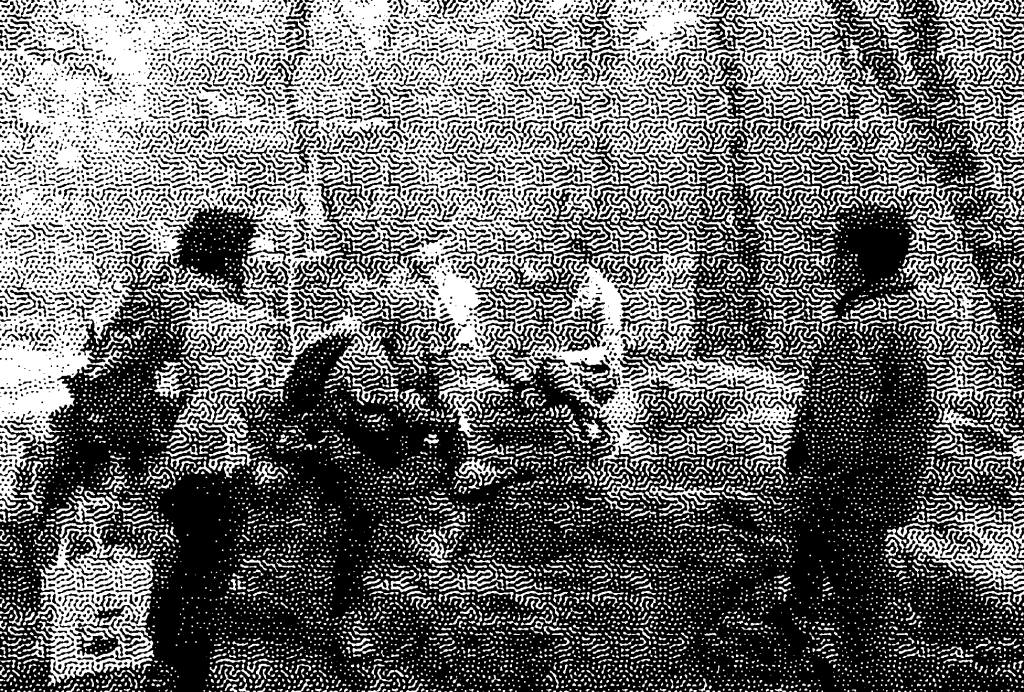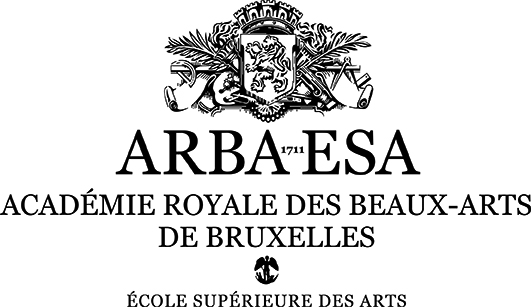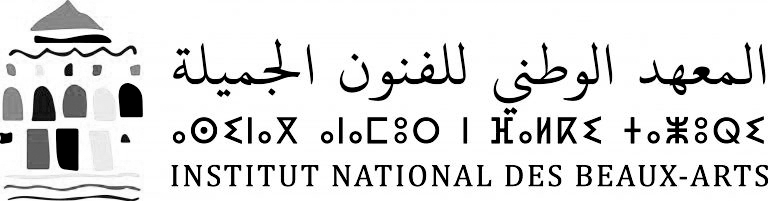Il est très délicat d’aborder la question de la liberté de la création sans parler de la liberté politique. Hannah Arendt avait déjà pressenti la distinction dans La Crise de la culture (1960), où tout un chapitre était consacré à la question de « la liberté » :
L’important n’est pas ici de savoir si l’artiste créateur est libre dans le processus de création, mais de savoir que le processus créateur ne se déploie pas en public et n’est pas destiné à faire son apparition dans le monde. Donc l’élément de liberté incontestablement présent dans les arts créateurs reste caché; ce n’est pas le libre processus créateur qui finalement fait son apparition et importe au monde, mais l’œuvre d’art elle-même, le produit final du processus.
Hannah Arendt
« L’écrivaine »
et philosophe du politique nous précise que le concept de liberté trouve ses fondements en Occident dans les expériences de l’Antiquité grecque. Elle affirme :
Toute tentative pour dériver le concept de liberté d’expériences du domaine politique semble étrange et saisissante parce que toutes nos théories en ces matières sont dominées par l’idée que la liberté est un attribut de la volonté et de la pensée plutôt que de l’action.
Hannah Arendt
Arendt a également approfondi le concept d’action dans cet autre important texte qu’est la Condition de l’homme moderne, où l’agir humain entre en interaction avec le monde et la pensée. C’est une évidence de parler aujourd’hui de « liberté » en évoquant la « volonté d’être libre ». Ainsi, les individus ont des désirs et, coûte que coûte, ils cherchent à les réaliser. Nos sociétés capitalistes néo-libérales et hystériques font la promotion des libertés à un niveau presque insoutenable. Bien sûr, si vous en avez les moyens! Les plus privilégiés affichent sans retenue leur impressionnante liberté de choix comme une affirmation suprême de la vraie liberté.
Faudrait-il rappeler qu’au XVIIe siècle, un humble et reclus libre-penseur, Benedictus de Spinoza, avance dans L’Éthique (1661-1675) une proposition incompréhensible pour l’époque : nos volontés ne sont pas libres, mais conditionnées. De plus, il termine son impressionnante démonstration en promouvant que la « puissance de l’intelligence » humaine et la « liberté » qui en découle peuvent conduire à rendre davantage conscient. Yves Citton, dans un livre essentiel traitant de L’Envers de la liberté, l’invention d’un imaginaire spinoziste dans la France des Lumières (2006), résume l’importance aujourd’hui de cette pensée :
Que nous disent explicitement ou entre les lignes, tous les travaux de psychologie, de psychiatrie, de neurologie, de pédagogie, d’anthropologie, d’ethnologie, de sociologie, d’économie, ou de marketing, sinon que nos « libres choix » sont conditionnés par les différents paramètres ayant régi l’interaction entre notre donné génétique, notre développement physique, notre environnement familial et éducatif, les coutumes dominantes autour de nous, les rapports d’intérêt structurant notre monde social, les images, les sons et les discours projetés sur nous à longueur d’année ? […] depuis une dizaine d’années, de nombreux scientifiques (en sciences de la nature comme en sciences sociales), de nombreux philosophes, activistes, écrivains et penseurs ont senti le besoin de « revenir à Spinoza dans la conjoncture actuelle présente ».
Citton, Y.
En résumé, nous sommes libres de dire « oui » ou « non », de choisir tout ce que nous voulons, de voter pour qui l’on croit, mais cette indépendance de choix n’est réelle qu’à la condition d’être pleinement conscient de ses causes, de ses limites et des actions qu’elle engendre. En fait, être conscient du sens éthique que la liberté jette sur le tapis.
Nos sociétés curieusement dites néolibérales ont réussi à ériger avec un sans-gêne outrancier l’idole de l’individualisme possessif tout en transformant tout processus de liberté de choix et de préférence en, d’une part, une englobante activité consumériste ou, d’autre part, une forme sociale consensuelle de procédure électorale. Être libre ou manger toute la misère du diable.
Revenons à cette place singulière qu’Hannah Arendt accorde à l’acte de création. Les citations d’artistes qui témoignent de l’importance de la notion de liberté dans le travail de création sont légion.
J’ai eu la chance d’enregistrer les derniers propos de Fernand Leduc,
peintre québécois important et signataire du manifeste Refus global (1948), qui a été un texte fondateur de la modernité au Québec. Cette rencontre filmée a donné lieu à un document unique où il fait le point sur ses convictions d’artiste. Il explique, entre autres, comment Paul-Émile Borduas, leader du mouvement automatiste, a été un maitre pour lui. Après avoir expliqué les leçons qu’il tire de la rencontre avec ce peintre, il termine par une forme d’invocation : « (…) si vous êtes véritablement en état de créativité, vous trouvez ce qui est de plus important dans la vie, la liberté ».
Mario Côté
Le philosophe Paul Audi, dans une conférence prononcée à Rennes sur la question de la légitimation actuelle de l’artiste,
place la question de la liberté au centre de son argumentation.
Originellement, comme on le sait, « créer » diffère de toute activité de production en ce qu’il se rapporte à l’acte de croitre; en ce sens, « créer » (creare) veut dire croitre, faire. Se déployer, faire s’épanouir – mais quoi en l’occurrence ? Nul autre que le possible. Créer consiste à faire en sorte que le champ des possibles s’accroit miraculeusement, et cela pour que la vie elle-même s’accroisse de soi, ce qui veut dire : se porte à une richesse insoupçonnée, à des potentialités nouvelles, ce qui ne laisse pas d’être chaque fois bouleversant.
Paul Audi
Créer n’est pas qu’un acte qui conduit à réaliser, à produire manuellement ou conceptuellement un objet, il doit devenir une « possibilité » dont la qualité est d’être inédite. La création implique pour l’artiste de réunir les conditions à ce que tout a priori, tout cliché, tout conditionnement ne puissent influer sur le processus afin de partager avec la vie, avec l’autre, cette possibilité dérangeante, saisissante, étonnante, inouïe de créer. Audi nomme cette responsabilité attribuée à la création comme étant celle de produire une émotion, de l’imaginaire.
(…) s’il est vrai que sa responsabilité en tant qu’artiste réside dans le respect qu’il éprouve (qu’il s’estime voué à éprouver) envers ce curieux « impératif » qu’il ne fait jamais que s’imposer à lui-même, en-dehors de toute contrainte morale, de toute législation transcendante, au nom de sa liberté même : l’impératif d’inaugurer, et partant d’inventer pour soi comme pour autrui, des manières de sentir, d’imaginer et de penser dont nul n’aurait pu croire auparavant qu’elles puissent un jour voir le jour.
Paul Audi
Cette liberté-artiste que doit s’approprier tout créateur serait celle de la distance, de la volonté de dire « oui » ou « non », de mettre de côté toute séduction, toute facilité, tout préjugé, toute tentative consumériste, toute injonction institutionnelle et culturelle qui ne peut que conduire à devenir asservissement ou isolement volontaire.
Certes la tâche demeure immense et relève presque de l’utopie ou d’un « devenir », concept que Deleuze a si bien actualisé.
La vie d’artiste, comme celle d’artiste en formation, est constamment assaillie par des contradictions, des paradoxes, traversée par des multiplicités d’être et constituée de forces actives et réactives. La notion-vrille de liberté-artiste, notion-perceuse de liberté, continue de faire son chemin et peut être dorénavant envisagée d’un point de vue éthique. Éthos entendu comme la manière d’être et la manière de se conduire. En fait, être-artiste comme responsable envers soi et les autres dans la prise de décisions et les devenirs conséquents. La liberté-artiste serait aussi un choix politique pour plusieurs raisons, mais la principale considération que chaque artiste se donne est celle de défendre face à la société le droit de créer librement. Et ces prérogatives ne peuvent qu’être dérangeantes, ennuyeuses et agaçantes pour toute institution; il ne convient qu’aux intéressés d’en être conscient et agissant.